Poème sans fin de 1001 à 1250 vers
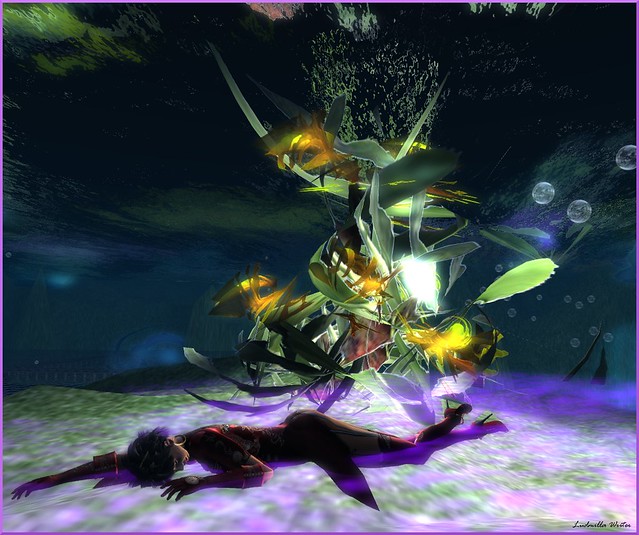
Au bout de la table, une clochette à la main
Le père Claude gardait les yeux fermés,
Derrière ses paupières regardant le divin,
Le 25 décembre, ma première journée.
En ce jour de Jésus, en ce jour de naissance
En ce jour de Noël accoudé les mains jointes,
Je regardais dans l'âtre le chaudron qui balance,
Et Claude retournant les braises d'une pointe,
À l'égal du glaive d'un vaillant chevalier,
Pestant contre le feu, frappant le diable,
Crevant le ventre des bûches au brasier,
Alors que l'on attendait autour de la table,
On attendait, le doux moment propice,
Le bruit de la clochette ouvrant le festin,
L'un près de l'autre le ventre au supplice,
Montaient les lueurs de mon premier matin.
Dieu, que l'aube était tendre et caressante
J'avais comme l'impression de vous entendre,
D'ailleurs, vous entendais-je peut-être,
Ou était-ce le chant léger de la cendre,
Parfois, votre voix, encore, me pénètre.
Allons ! Que je vous dise, ce qu'il en fût.
En ce lieu où le silence était partout,
Où les murs transpiraient leur peau nue,
Où le vent frais venait souffler les joues.
Je me souviens de Claude levant sa main,
Brandissant le tisonnier vers le ciel,
Comme pour implorer je le crois bien,
Tous les anges et tous les saints éternels.
Il y avait là, un arrière-goût de croisades,
Suscitant l'envie d'aller guerroyer,
D'aller batailler, d'aller en nomades,
Par tous les déserts, d'aller foudroyer,
Ces êtres nauséeux, à l'esprit satanique
Qui peuplent le monde de laideur,
Les rendre fous de nos ailes magiques,
Et semer à tous les vents le bonheur.
Non, que nous ayons l'esprit sanguinaire,
Étant plus enclin à la méditation,
Mais qu'il était joyeux et salutaire,
D'espérer, un monde de raison.
Car, sur cette basse terre tant misérable,
Où ne vont que les souffles démoniaques,
Où les nuages même, à eux, sont semblables,
Où les parfums ont une odeur d'ammoniaque,
Rien, mises à part, nos prières incessantes,
Notre foi en vous. Vous, à la bonté infinie,
Ne peut sur les chemins toujours en pente,
Faire vibrer sous vos cieux les petites vies.
Malgré la cheminée grande ouverte,
Le froid, peu à peu, me gelait le corps,
Autour de moi des visages inertes,
Et des murs pris de vide en décor.
Je me souviendrai fort longtemps,
De ces faces aux bouches closes,
Moi qui n'étais alors qu'un enfant,
Eux, qui étaient toute autre chose.
C'était, presque comme un rêve
Un rêve éveillé après ma nuit blanche,
Après le tumulte une sorte de trêve,
Sur lui qui prenait sa revanche.
« Donnez-nous, notre pain quotidien »
Entonna Claude d'une voix de ténor,
« Chassez le mal, faites le bien »
« Faites que l'amour soit le plus fort »
« Pardonnez nos offenses »,
« Pardonnez au monde ses misères »
« Pardonnez mon ignorance »
« Dites-moi, que puis-je faire ? »
Et la clochette me sortant de ma torpeur,
Brillant sous le feu, tinta dans la salle,
Claude ouvrit ses mains de prieur,
Déjà les murmures dans l'aube hivernale.
« Quel est ton nom ? » à mon oreille,
« D'où viens-tu ? » Face à moi,
« Quel âge as-tu ? » à l'autre oreille,
« Sais-tu vraiment, ce qu'est la foi ? »
Qu'est-ce que la foi ? Un mystère !
Un partage ! Mais partager quoi ?
Une vie paisible ou d'horribles guerres.
Monter ensemble au chemin de croix ?
Croire en vous, qui êtes partout
Est-ce cela ? Seigneur, Mon Dieu.
Peut-être, aussi, est-ce être fou,
Peut-être, aussi, être amoureux.
Que pouvais-je répondre ? De fait,
A Claude, à ceux qui furent mes frères
Je n'avais su que baisser la tête,
Alors que la foi, n'est que lumière.
Et l'ange noir passa, son haleine fétide
Je fus, sans doute, seul à le voir,
Là, sur la table, dans mon bol vide,
Là, comme un vague désespoir.
Je revoyais, la campagne étendue
Mon enfance joyeuse de tout,
Mes courses, dans les champs, éperdues,
Et l'ange, toujours, me poussait dans le trou.
Je revoyais Bénédicte cueillir des fleurs,
Faire des bouquets de coquelicots,
De jonquilles chargées de senteurs,
Je la revoyais sous l'arbre aux oiseaux.
Et l'ange passait, entre les chaises
Montait au plafond en souriant,
Allait se rouler dans les braises,
Et frôlait mon épaule par moments.
Il est bien douloureux, de tout changer
De quitter sa famille, enterrer le passé,
Quitter le bonheur, de tout déranger,
Et combien difficile de tout effacer.
C'était sans doute cela, l'ange noir
Le messager de ce temps révolu,
Cette image perdue derrière le miroir,
L'image d'un paysage fendu.
Alors que chacun repliait sa serviette,
Que mes frères se levaient un à un,
Que sur la table ne restaient que des miettes,
Ce jour-là, je n'avais pas de faim...
1115
Elle courait, sa robe légère dans le vent
Telle une sylphide autour de la fontaine,
Le soleil donnait de ses yeux rayonnants,
C'était jour de fête, de fête foraine.
Il y avait là les grands échassiers,
Venus des Landes que je ne connais pas,
Où, paraît-il, ne sont que de longs sentiers,
Et où tous les arbres se tiennent droits.
Elle courait en tous sens sur les pavés,
Mais la tristesse se lisait dans son regard,
Je ne savais dans l'instant d'où elle était,
Je l'avais remarquée juste par hasard.
Je la regardais, elle ne me voyait pas
Comme prise par des joies éphémères,
Je la regardais et au fond de moi,
Je sentais venir sa grande misère.
Bien sûr que sur cette place de Louvine,
Alors que riaient des familles entières,
Que les amours allaient clandestines,
Il n'y avait que de belles lumières.
Bien sûr que les ouvriers et les paysans,
Se mêlaient à l'honorable bourgeoisie,
Pour sûr c'était un arrêt dans le temps,
Où chacun faisait aller sa fantaisie.
Mais je ne voyais qu'elle, en pauvreté
Était-ce ma foi qui l'espérait ainsi ?
Pour avoir trop bu à la source des pitiés,
Étais-je fou au nom de Jésus Christ ?
Je la regardais valser sur le pavé,
Virevolter, chanter comme un oiseau,
Parfois je sentais mon cœur à s'envoler,
À s'envoler vers elle plus qu'il ne faut.
J'en aurais presque oublié le serment,
Celui que j'avais fait deux ans plus tôt,
Pour le nom de Dieu, éternellement
Pour celui qui fit la terre et les cieux,
Qui fit l'homme que je suis, ici-bas
La rivière, le ruisseau langoureux,
La prairie, la clairière et le bois.
Il me l'avait bien dit le père Claude,
« Toujours se méfier d'une belle qui passe
Toujours aussi d'un parfum qui rôde, »
Mais, elle, je l'admirais dans l'espace.
Que Dieu pardonne un tant soit peu,
Mes égarements ce jour de fête,
1160
Où tout me semblait si délicieux,
Que j'en perdais par trop la tête.
Et elle courait, courait encore',
Juste pour mes yeux contemplatifs,
Je voyais ses cheveux en fils d'or
Une chaîne, une croix en pendentif.
Elle riait de sa belle voix claire,
Souriait à ceux qui passaient là,
Mais je la voyais prisonnière,
Malgré au 7e jour, le shabbat.
Que Dieu en qui je crois et prie,
Pardonne aussi la déraison,
Ce moment où il me prit,
De regarder son blanc jupon.
1174
Je ne savais plus sur ma terrasse,
Ce qu'il était des communions,
Comme un ciboire buvant ma tasse,
Et cette hostie en un quignon.
Les échassiers de leur hauteur,
Surveillaient la gent enfantine,
La marmaille, le ballon voleur,
Les cerceaux et les gamines.
Sur quelques bancs pour l'occasion,
Les vieux parlaient, voire chuchotaient,
Murmurant des « dira-t-on »,
Des commérages, ils blablataient.
« Tu as vu la Julienne et son chapeau,
Trop de couleur et trop de fleurs ».
« On dit son homme être un soûlot,
Et qu'à rentrer il n'a pas d'heure' ».
Puis il y avait cet autre criard,
Ses baudruches, ses sucres d'orge,
Haranguant le passant goguenard,
En raclant le fond de sa gorge.
Et partout le soleil contemplatif,
Dans la folie d'une kermesse,
Pas un nuage au ciel passif,
Le peuple heureux, le peuple en liesse.
Et moi, j'admirais de la tonnelle,
Je regardais tourner les palombes,
Voler, là-haut des hirondelles
Et sur le toit les deux colombes.
Je regardais de la terrasse,
Du petit ''Hôtel des Voyageurs'',
Marcher les ombres sur des échasses,
Et les jeunes gens chanter en chœur.
Et sans cesse j'admirais la belle,
Sur le pavé luisant du bonheur,
Son corps fragile sous la dentelle,
Valser comme au vent les fleurs.
Mon Dieu pardonnez-moi encore',
Moi le simple curé du village,
Mais son parfum doux était si fort,
Que mon esprit s'en allait volage.
Plus elle tournait et plus je chavirais
Dans ses sortes de méandres,
Plus elle tournait et plus j'espérais,
Que le diable ne puisse me prendre.
Ô, mon Dieu que d'indécence,
Alors qu'il n'est que pour vous,
Mon cœur dans les luminescences,
Vous qui êtes par-dessus tout,
Ma seule et grande lumière,
Dans ce monde qui me rend fou,
Qui devez être, dans mes prières,
L'unique être que je loue.
Mais, que faire quand parle le corps,
Que faire, de cette souffrance
Je suis un homme, est-ce un tort ?
Je suis un homme, quoi que l'on pense.
C'est alors, que le soir naissant,
Je repris par les ruelles étroites,
Le chemin me ramenant,
Au presbytère et au lit moite.
Je laissais donc, avec regret
Comme un souvenir qui se consume,
Toutes ces âmes qui volaient,
Dans le silence de la brume.
Je laissais là, une fontaine,
Des guirlandes, des ballons morts
Les yeux brûlant de peine,
J'abandonnais le doux décor.
Mon Dieu, mais qu'ai-je fait,
Ce jour-là sur la terrasse,
Que je crus que s'effaçaient,
Mes pensées, pour vous, hélas.
Dans le lointain, un dernier son,
Un sifflement, un oiseau-lyre,
Chantait la douceur de son prénom,
Elvire.
1250






